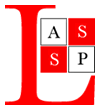Laure Teulières, Steve Hagimont, Jean-Michel Hupé (dir.), Greenbacklash. Qui veut la peau de l’écologie ? Seuil, Collection « Écocène », 256 pages – 21,50€
Les vingt-six chapitres réunissent les contributions d'une trentaine de chercheur.euses et de témoins privilégiés, venus d'un large horizon disciplinaire, dont Michitake Aso, Geneviève Azam, Gabrielle Bouleau, Christophe Cassou, Maria Conde, Eve Darian-Smith, Elsa Devienne, Jean-Baptiste Fressoz, Stéphane Foucart, Eve Fouilleux, Clémence Guimont, François Jarrige, Sylvain Laurens, Valérie Masson-Delmotte, Emmanuelle Pérez-Tisserant, Héloïse Prévost, Luc Semal, Isabelle Stengers, Lucien Thabourey...
Présentation de l'éditeur :
Greenbacklash, ou ces vents contraires qui veulent nous faire croire que les écologistes ont plus insupportables que le désastre écologique. Le succès électoral croissant des extrêmes droites européennes s’est appuyé sur des programmes ouvertement anti-écologiques. Nombre de situations et d’événements ont montré la difficulté de mettre en œuvre une transition écologique à la hauteur des enjeux sans que cela ne suscite de puissants retours de bâton. Ce mouvement, dont le livre propose un tour d'horizon mondial, a été qualifié de « backlash écologique ». Un mouvement qui n’hésite pas à contredire des faits scientifiques – par exemple sur le changement climatique – et dont l’une des principales revendications est la « simplification » du droit de l’environnement. À la suite de Greenwashing, Greenbacklash propose une cartographie des arguments, des interventions, des stratégies, des institutions en opposition, voire des franches obstructions aux transformations écologiques. Par qui, comment, où, depuis quand ? Telles sont les questions auxquelles répond cet ouvrage collectif d'auteurs, à la pointe du sujet, qui analyse les effets complémentaires de ce phénomène, venant des années 1980, et désormais de plus en plus affirmés, qui brouillent le débat public et l’action collective.
L'ouvrage sera présenté à Toulouse par sa coordinatrice et ses coordinateurs :
- le 25 octobre à 17h à la librairie Ombre blanche
- le 12 novembre à 17h avec Eve Fouilleux et Markku Lethonen, Salle Osète.(lors d'un séminaire de l'Atécopol)
------------------------
TABLE
Introduction . 11
Chronique des années 2020, 12. — Greenbacklash : juste retour des choses ou vengeance réactionnaire ?, 16. — Mécanisme structurel : le poids des héritages, 22. — Le déplacement matériel, financier et idéologique de l’économie mondiale, 25. — Impérialismes et autoritarismes, 29.
PARTIE I LES MATRICES DU GREENBACKLASH
La matrice étatsunienne du greenbacklash.
43 Aux origines du backlash étatsunien : « les marchands de doute », 43.— Du « renversement républicain » au Tea Party, 45. — L’ère de la post-vérité, 48. Du déni à l’attaque contre la science, aux États-Unis
et ailleurs. 52
Amériques latines : le continuum de l’extractivisme colonial
et néocolonial. 60 Dictatures et néolibéralisme de la guerre froide aux années 1990 : « Combattre l’enfer vert », 61. — Les gouvernements progressistes des années 2000 : entre Buen Vivir et néo-extractivisme, 63.— De Bolsonaro à Milei : droites et extrêmes droites au service du greenbackclash, 65.
Un backlash structurel : l’héritage matériel contre l’écologie ?. 69
La résignation climatique sous couvert de « transition », 71. — Quelle « écologisation » au regard des dynamiques matérielles ?, 74.
L’écologie face à un capitalisme survivaliste. 79
De l’adaptation néolibérale à l’accélération éco-moderniste, 80. — La liquidation libertarienne, 84.
Comment la Commission européenne détricote le Pacte vert. 88
La vague verte est terminée, 89. — Comment en sommes-nous arrivés là ?, 91. — Dérégulation et attaque contre la démocratie environnementale, 93. — L’écologie politique au défi de son élargissement social, 95.
Perspectives postcoloniales : écologisme, répression et résistance. 97
Développement et pouvoir de l’État, 98. — Travail, santé et environnement, 101. — L’impérialisme vert postcolonial, 103.— Repenser la résistance et l’autorité, 105.
Le contrecoup de l’extractivisme vert. 107
Les métaux de la décarbonation : cuivre, nickel, lithium, 108. — Les paradoxes de l’extractivisme vert, 112.
La montée de l’autoritarisme et l’instrumentalisation de la crise écologique. 116
Les trois caractéristiques communes des libéralismes autoritaires, 117. — La mise au pas des manifestants, 119. — L’aggravation du racisme environnemental, 122.
PARTIE II ÉLÉMENTS DE LANGAGE
« Les écolos sont catastrophistes ! ». 129
L’alerte écologiste et la réaction anti-catastrophiste, 131. — Quereproche-t-on aux écolos catastrophistes ?, 133. — Pour des études
empiriques du catastrophisme écologiste, 136.
« On n’arrête pas le progrès ! ». 138
Relancer le progrès, 138. — Aux sources d’un « étrange jargon », 140. — Ambivalences, 142. — Diversité des chemins, 144.
« L’écologie contre l’emploi et le social ». 147
La Hague, une critique syndicale progressivement éteinte, 149. — Un backlash pernicieux dans les conflits sur la régulation des usages de l’amiante, 151. — Défataliser le backlash, rendre visibles les luttes conjuguant la justice sociale et environnementale, 154.
« L’écologie, c’est pour les bobos » : la transition a-t-elle un problème de classe ?. 156
L’expérience du racisme environnemental, 157. — L’écologie des autres, 159. — Les mille visages de l’engagement, 161.
Du nimbisme au zadisme : (dis)qualifier les oppositions aux projets d’aménagement. 165
Multiplication des conflits, intensification du dénigrement, 166. — S’opposer aux projets de « transition écologique » : du greenwashing au greenbacklash, 169.
Vers un retour à la bougie ? Le nucléaire
face à ses « fossoyeurs ». 173
« C’est la faute aux écolos », 174. — Le « lobby anti-nucléaire » : un bouc émissaire trop commode ?, 176. — La promesse des SMR, 178.
« Le bio ne nourrira pas le monde ».
Le backlash institutionnalisé de l’agriculture biologique. 183 Bio ou pas, nourrir le monde n’est pas la vocation de l’agriculture française, 184. — Un backlash institutionnalisé par les politiques publiques, 187. — Sortir de la niche : la bio comme option agronomique et sociale, 190.
« Écologie punitive » : 50 nuances de clichés. 193
De quoi la punition est-elle le nom ?, 195. — Retourner l’argument de la sanction, 198.
PARTIE III ACTEURS ET INSTITUTIONS
Ce que le scientisme fait aux (sciences) terrestres. 205
Il était une fois le scientisme, 207. — Mais de quelle « Science » parle-t-on ?, 208. — Techno-solutionnisme, les nouveaux habits du scientisme, 209. — Les marchands de doute contre les savoirs critiques, 210.
« Lobbying » : un jeu de miroirs et d’écrans de fumée. 214
Un travail d’équipe, 216. — Tout le monde fait du lobbying, vraiment ?, 218. — Quand l’intérêt du privé devient le discours du public, 220.
Des médias contre l’écologie ?. 223
Disqualifier et maltraiter la cause, 225. — Les hérauts médiatiques de l’anti-écologisme, 228. — Les réactions au sein du monde des médias pour contrecarrer le backlash, 230.
L’environnement, la cause perdue par les pouvoirs publics. 232
L’environnement marginalisé, 234. — La gestion publique minimise l’ampleur des crises environnementales autant qu’elle les accentue, 236.
Le bashing des climatologues : attaquer les scientifiques du climat. 241
La parole publique du climatologue expose à être ciblé, 242. — Une façon décomplexée de retourner les arguments de la transition, 245. — En embuscade, des gouvernements et probablement des lobbys de géo-ingénierie, 247.
Défaire le droit de l’environnement. 250
Un droit sans application, 251. — Les pouvoirs de l’administration, 253. — Que font les polices ?, 255.
Répression : la criminalisation des mouvements écologistes . 259
Quand les mobilisations pour le climat étaient épargnées, 260. — Une répression qui s’amplifie partout en Europe depuis 2020, 262. — Comment expliquer ce durcissement ?, 264.
Industriels et milieux d’affaires : entre attaques frontales et compromis impossibles. 267
Les entreprises et leurs porte-paroles, 267. — Obstructionnistes et capitalistes verts, 270. — Compromis impossible, 272. — L’argent des milliardaires pour retourner l’opinion, 273.
L’agro-industrie et ses alliés . 276
Une omerta sur les enjeux agro-écologiques, 277. — L’écologie comme ennemi tutélaire, 279. — De la victimisation au devenir fasciste de l’agro-industrie, 281