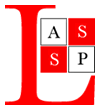Vous êtes ici :
- Accueil
- Actus
- Agenda
- Soutenance de thèse,
Soutenance de thèse : Léo Fortaillier « Lutter contre la xénophobie par la cohésion sociale : la (dé)politisation ambivalente d'une mobilisation sans protestation dans la ville du Cap ».
le 3 octobre 2025
« Lutter contre la xénophobie par la cohésion sociale : la (dé)politisation ambivalente d'une mobilisation sans protestation dans la ville du Cap ».
La soutenance aura lieu le 3 octobre 2025 à 14h à Sciences Po Toulouse, salle du Conseil (21 allées de Brienne, 31000 Toulouse). Si vous souhaitez y assister sur Zoom merci de me l'indiquer à l'adresse suivante : leo.fortaillier@univ-tlse2.
Le jury sera composé de :
- Emmanuelle Bouilly, Professeure, Université de Lille (Rapportrice)
- Sandrine Lefranc, Directrice de recherche, Sciences Po (Rapportrice)
- Laurent Fourchard, Directeur de recherche, Sciences Po
- Aurelia Segatti, Docteure en science politique, Organisation internationale du travail
- Lionel Arnaud, Professeur, Université Toulouse III Paul Sabatier (directeur de thèse)
Le résumé de la thèse : La thèse explore l’ambivalence des processus de (dé)politisation à l’œuvre au sein de programmes portés par des ONG du Cap, en Afrique du Sud, qui visent à lutter contre la xénophobie. Elle s’appuie sur une enquête ethnographique et socio-historique menée entre 2016 et 2019 au sein de ces programmes. Cette méthodologie a permis d’établir une monographie comparée attentive à la fois aux points communs et aux spécificités de chaque cas étudié. L’enquête mobilise une grille de lecture tripartite du « politique » : institutionnelle, interactionniste et conversationnelle. L’approche institutionnelle permet d’abord de comprendre la construction sociale de la dépolitisation en tant que processus de labellisation, au travers notamment de la catégorie de « cohésion sociale ». Cette « politique de la dépolitisation » passe par des jeux d’acteurs et de positionnement visant à tenir à distance toute qualification explicitement politique, en s’appuyant sur des dispositifs de formations, de dialogue, ou mobilisant des formes d’agir culturel. Or, c’est précisément à cette dimension institutionnelle que se limitent nombre d’analyses classiques sur les ONG. Si cette première étape est nécessaire, elle demeure insuffisante : les résultats produits restant aveugles aux dimensions interactionnistes et conversationnelles qui permettent de saisir le retour ambivalent du refoulé politique. L’approche interactionniste permet d’appréhender les tensions et difficultés liées à la mise en œuvre concrète d’instruments présentés comme dépolitisés, lorsqu’ils rencontrent le terrain – en l’occurrence, les townships du Cap. Ces dispositifs sont en effet mobilisés par des acteur·rices plus ou moins éloigné·es de leurs logiques, qui disposent de marges de manœuvre pour s’en saisir, les contourner, voire les réinterpréter. L’approche conversationnelle, qui insiste sur la façon dont le politique peut être repéré et construit dans les discours et la dénonciation publique, permet alors d’appréhender que cette rencontre se traduit parfois par une repolitisation partielle, souvent limitée et ambigüe. In fine, l’analyse de cette dialectique entre les programmes, celles et ceux qui les mettent en œuvre et les contextes locaux permet de dépasser l’idée d’une dépolitisation descendante et linéaire transmise du niveau international au niveau local, et d’appréhender au contraire des processus de traduction, d’ajustement ou de résistance. Les outils de la sociologie des mouvements sociaux, souvent centrés sur des engagements explicites et revendicatifs ne permettant pas toujours de saisir les ambiguïtés des mobilisations sans protestation, nous les complétons par ceux de la sociologie de l’institution, de l’action publique et de la socio-anthropologie du développement, plus attentifs aux circulations, aux ambivalences et aux ajustements entre niveaux d’action.